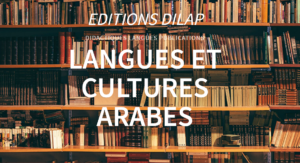Les séries télévisées égyptiennes (1)
________________
Vues par Zeinab ZAZA
___________________
Épisode 1
L’histoire d’AMINA
Vous je ne sais pas, mais moi, quand je regarde mes séries sur youtube, je peux même oublier d’aller faire pipi. Donc, voilà, j’ai encore oublié l’heure de la prière.

Quoi ? Oui, la prière. Là j’ouvre une parenthèse, pour vous dire comment c’est bien d’être musulmane en France : d’abord on n’est pas dérangée par l’appel à la prière, qui n’est pas toujours mélodieux, loin s’en faut. Si on y tient, on peut toujours télécharger l’appli. Ensuite, on est protégée par les lois de la république, la république française, je veux dire, celle qui est laïque ; en Égypte aussi, que Dieu garde, on a une république, mais elle n’est pas laïque. C’est à dire qu’ici, on n’a pas à craindre la polygamie, ni la répudiation unilatérale, ni que nos frères héritent le double de notre part. À part ça, on fait ce qu’on veut, on peut pratiquer un islam esthétique, soufi, « cute », comme on dit en Égypte (c’est un mot anglais, s’il vous plaît, il faut prononcer kioute), et tout va très bien.
Je ferme la parenthèse. Revenons à ma série. Le vieux millionnaire épousera-t-il la danseuse ? La riche divorcée épousera-t-elle son coach sportif ? Le suspense est insoutenable. Les séries égyptiennes ne se lassent pas des histoires de mésalliances, ce qui me fait penser à une de mes amies d’enfance, une qui est restée là-bas, et quand je pense à elle, je suis triste, vous allez comprendre pourquoi.
Comme moi, elle est née dans les années cinquante dans une famille tout ce qu’il y a de convenable, aisance, parents éclairés, éducation en français. Elle était belle, sérieuse et brillante, et évidemment elle est entrée à la faculté de médecine. Elle a perdu son père vers l’âge de quinze ans, un père adoré qui lui a donné une haute idée de sa valeur personnelle et de la responsabilité incombant à sa classe sociale, contrepartie de ses privilèges.

Mais voilà qu’elle rencontre un garçon qui ressemble à Henry Fonda en plus brun, et qu’elle en tombe amoureuse. Jusque là tout va bien. Il est ingénieur, fils d’un haut fonctionnaire de l’entourage du président Anouar el Sadate. Encore mieux. Mais évidemment, il y a un mais : ses frères et oncles, mieux renseignés qu’elle, s’opposent à ce mariage (ça se passe en Égypte, n’est-ce pas ? Pas question d’aller au cinéma avec un garçon si on n’est pas au minimum fiancée avec lui). Pourquoi cette opposition, me direz-vous ? D’une part parce qu’elle n’avait pas fini ses études, et d’autre part parce que si Henry Fonda était fils d’un haut fonctionnaire très respecté, sa mère par contre n’était que la gouvernante du papa, autant dire une bonne, on ne le dit pas parce que ça se passe dans la haute société.
Et alors ?
Et alors mon amie, Amina, brave sa famille et épouse Henry Fonda, qui la fait vivre dans un bel appartement, où il a également installé sa mère, en bon fils égyptien, parce que son père vient de mourir. Maman ne peut pas vivre seule, ça ne se fait pas, et c’est le devoir du fils de s’en occuper.
Bien évidemment, Maman ne peut pas voir Amina en peinture, elle est d’un milieu différent et ça se sent. Pourtant Amina est enceinte, accouche d’un beau garçon et pouponne tout en terminant ses études de médecine. La vie est difficile, Henry Fonda s’absente beaucoup (il fait des affaires, on ne sait pas bien lesquelles, et il possède de la terre dans la région du canal de Suez). Amina, enceinte à nouveau, produit une fille ravissante, mais ça n’adoucit pas Maman qui la persécute, et Henry Fonda, même quand il est là, ne la défend pas. Elle passe même une nuit enfermée sur le balcon parce qu’elle a osé répondre à Maman. Il semble lui en vouloir d’être aussi différente de sa mère, de parler français, de ne pas aimer les fleurs en plastique.
À nouveau enceinte, elle a cette fois deux jumeaux, un garçon et une fille. Tout ce monde là grandit un peu et va à l’école la plus chère de la ville. Maintenant, Amina peut travailler et aussi passer son doctorat. Elle a fait une spécialité d’oncologie, et comme elle fait tout très bien, elle est brillante – et détestée. Pas seulement par sa belle-mère, mais aussi par son entourage professionnel, dont elle voit trop souvent la corruption, et elle est incapable de se taire. Ce qui recule beaucoup son accès au titre de docteur.

La belle-mère décède enfin.
Entre temps, bien des choses ont changé en Égypte. La politique de Sadate a fait sortir de l’ombre des cachots les Frères Musulmans, supposés arme de choc contre le péril marxiste, et qui finiront par assassiner leur bienfaiteur. La paupérisation due à la politique
La politique « d’ouverture » et à la démographie galopante assortie d’une régression de la scolarisation a poussé de nombreux hommes dans les bras des pays du Golfe en demande de main d’œuvre, et ils en reviennent souvent barbus et avec un discours religieux jusque là très marginal en Égypte. Sans que ce soit jamais inscrit dans la loi, les femmes se couvrent les cheveux et bientôt il n’y a plus que les Chrétiennes et quelques récalcitrantes qui ne portent pas le « higab ». Amina est de celles-là. Croyante et pratiquante, elle continue à penser que la religion est une affaire privée et qu’une tenue décente suffit.
À nouveau enceinte, elle a cette fois deux jumeaux, un garçon et une fille. Tout ce monde là grandit un peu et va à l’école la plus chère de la ville. Maintenant, Amina peut travailler et aussi passer son doctorat. Elle a fait une spécialité d’oncologie, et comme elle fait tout très bien, elle est brillante – et détestée. Pas seulement par sa belle-mère, mais aussi par son entourage professionnel, dont elle voit trop souvent la corruption, et elle est incapable de se taire. Ce qui recule beaucoup son accès au titre de docteur.
Elle rentre à temps pour recevoir les enfants et faire déjeuner tout le monde (en Égypte on déjeune vers 15 ou 16h).
Elle suit de près le travail des enfants.
Elle prend le mari quand il arrive, et s’il rentre de la campagne avec trois cageots d’aubergines, elle passe la moitié de la nuit à les confire avant qu’elles ne pourrissent.
Mais Henry Fonda ne va pas bien. Il supporte mal que sa femme soit docteur. Et puis, pourquoi elle ne se couvre pas la tête, comme tout le monde ? Et puis il disparaît. Et puis il revient et devient de plus en plus critique, puis insultant, puis violent.
Elle finit par demander le divorce. Il refuse. En fait dans les pays musulmans, il n’y a pas de divorce, ça s’appelle une répudiation et c’est un verbe dont seul l’homme peut être le sujet, la femme ne peut en être que complément d’objet direct. Elle demande donc à être répudiée, mais Monsieur peut refuser et la laisser en suspens toute sa vie. Si elle quitte le domicile conjugal, y compris soutenue par sa famille, il peut recourir à la police pour lui faire réintégrer « la maison d’obéissance ». Il ne veut pas la répudier. Il veut pouvoir continuer à la maltraiter en tout bien tout honneur.
Amina découvre alors que Henry Fonda a épousé une autre femme (c’est son droit), entièrement voilée, style boîte aux lettres (c’est son kif). Un jour où il a été particulièrement violent, elle se résout à porter plainte, mais ça ne suffit pas à obtenir une répudiation, elle n’obtient que quelques bonnes paroles, et si il en est arrivé là, c’est qu’elle l’a provoqué, il faut être un peu souple, et comprendre que les hommes sont stressés par leur travail et peuvent parfois se montrer nerveux.

Alors elle a recours à une nouvelle loi qui a vu le jour en 2000 : le khol’, mot rébarbatif à prononcer en français, et dont la racine arabe signifie « déshabillage ». Il s’agit du droit pour l’épouse de se défaire de son mari comme d’un pull qu’on enlève, mais il y a des conditions : elle doit rembourser son « mahr », c’est à dire l’argent versé par le mari à la famille de la fille pour pouvoir l’épouser, et renoncer à tous les droits qu’elle aurait (peut-être) pu faire valoir en cas de répudiation, la pension alimentaire, par exemple.
Amina hésite beaucoup. Elle a peur pour ses enfants.
Finalement elle décide que l’argent ne sera pas un souci. Les enfants ont un peu grandi, elle prend un deuxième emploi le soir, dans un laboratoire d’analyses, en-dessous de ses compétences, mais tant pis.
Et la voilà libre, malgré différentes manœuvres d’intimidation. Elle se réconcilie avec sa famille qui la soutient un peu, au moins moralement. Par contre, le père ne veut plus voir ses enfants, qu’il estime pervertis par leur mère impie. Bien entendu, il ne verse pas un sou pour eux.
Et Amina continue son chemin, droite, grande, altière, les enfants continuent à fréquenter la même école chic et Dieu merci, ils réussissent. Tous les jours, à l’hôpital où elle est maintenant chef de service, on lui explique combien elle serait plus jolie avec un voile, mais elle ne se laisse pas convaincre.
Quelques hommes lui tournent autour, mais elle a perdu confiance. Elle fait très attention à ses paroles, à sa conduite. Elle est une femme sans homme, donc exposée à toutes les convoitises, à toutes les médisances. Elle engueule tout le monde et rend service à tout le monde, discrètement et sans jamais renoncer à la défense des malades démunis.
Elle prend sa mère chez elle et la soigne jusqu’à sa mort. C’est très dur, mais elle sait que c’est son devoir.
Elle a l’âge de la retraite, mais elle continue à travailler. Ses enfants, malgré ses craintes, ont pu faire des mariages qui semblent réussis, elle est plusieurs fois grand-mère.
Mais la solitude lui pèse.
Je voudrais bien lui faire rencontrer mon voisin d’en-dessous, au Caire…
Voilà, moi qui ai un mari français qui m’exaspère parfois mais me respecte et me fait rire, quand je pense à ce qu’elle a vécu et à ce qu’elle n’a pas vécu, je suis triste.
Allons, je vais la faire, cette prière…
—————————————–
Épisode 2
Je ne veux pas me marier
Dans les intérieurs égyptiens des années soixante, il y avait deux incontournables de la décoration : au salon, la photo de mariage ; dans la chambre à coucher, au dessus du lit conjugal, le tableau au point de croix représentant soit une danseuse, soit une femme allongée assez peu vêtue. Et sur le lit, une poupée assise au milieu de ses jupes à volants.
En arabe c’est le même mot pour fille à marier, jeune mariée et poupée : Aroussa.

La photo de mariage, la ravissante jeune femme en robe blanche, généralement assise, avec près d’elle le marié (la dominant parce qu’il est debout) en costume sombre, je mentirais en disant que nous n’en avons pas toutes rêvé.
Bon, rêver est une choses, mais surtout il faut trouver un mari, et ce de préférence avant la fatidique trentaine. Ce qui n’est pas si facile que ça, dans un contexte économique difficile où les exigences des familles sont rarement revues à la baisse.
En 2009 paraissait au Caire un petit livre qui est rapidement devenu un best-seller : « Je veux me marier », par Ghada Abd el Aal, jeune pharmacienne et blogueuse de talent, qui y raconte sur le mode comique les mésaventures d’une jeune fille à la recherche d’un mari. Ce livre a été traduit en français par Marie Charton et publié aux éditions de l’Aube en 2014 sous le titre « La ronde des prétendants ». Il avait auparavant été adapté en série télévisée en 2010, sur un mode excessivement burlesque qui, malgré l’excellence des acteurs, ne rendait pas justice, selon moi, à l’humour percutant du livre. Je l’ai quand même regardée jusqu’au bout, par sens du devoir de chroniqueuse.
Donc, je veux, tu veux, elle veut se marier… pas toutes, pourtant…
Aujourd’hui je voudrais dire un mot de Raga, qui ne figurait pas dans la série.
Raga est copte orthodoxe, c’est à dire chrétienne de l’église autonome d’Égypte, c’est à dire appartenant à une minorité religieuse d’environ 10 %, sachant qu’il n’existe pas de chiffres fiables.
Les églises d’orient, c’est un peu compliqué ; par exemple, n’allez pas imaginer que ces Chrétiens là ressemblent à ceux du Liban, ou du moins à l’image qu’on en a : riches, occidentalisés etc. En fait, les Coptes ressemblent beaucoup aux Musulmans, même s’ils s’en défendent. Les différences qui sautent aux yeux, c’est le fait qu’en ville, leurs femmes ne sont pas voilées et affectionnent les jupes s’arrêtant aux environs du genou, quels que soient leur âge et leur taille, du 36 au 56, et bien sûr la décoration des intérieurs : pas de versets coraniques ni de vues de la Mecque (cadrage savant qui cache la diabolique et criminelle horreur architecturale écrasant le sanctuaire), mais le calendrier du Patriarcat, des icônes et des chromos représentant la Sainte Famille. À part ça, la photo de mariage, le tableau au point de croix et la poupée sont à leur place attitrée. Autre différence, la cuisine : les Coptes ont environ 210 jours de jeûne par an, répartis en fonction du calendrier liturgique. Ce n’est pas un jeûne « complet » comme celui des Musulmans, mais ils doivent s’abstenir de tous produits d’origine animale. Ce qui fait qu’au lieu de cuisiner à la samna (beurre clarifié), ils cuisinent à l’huile, et l’odeur de leurs habitations est donc différente de celle de leurs voisins musulmans. Le reste du temps ils retrouvent la saine gastronomie égyptienne qui bouche les artères, mais la durée de nos vies est dans la main de Dieu, quel que soit le nom qu’on lui donne. D’ailleurs c’est le même, et leurs messes se disent en arabe et en copte, langue qui n’est plus que liturgique et s’écrit en caractères grecs augmentés de quelques uns.

Voilà pour les différences. À part ça, ils sont aussi chatouilleux que les Musulmans à l’endroit de l’honneur, qui comme chacun sait se niche dans les jupes des femmes et nulle part ailleurs, celles-ci sont d’ailleurs aussi excisées que leurs voisines musulmanes, oui, encore aujourd’hui.
Ah, j’oubliais, ils n’ont pas de divorce et doivent faire toutes sortes de manœuvres, dont la conversion à une autre église, pour pouvoir échapper à un mariage qui tourne mal. Inutile de dire que ce n’est pas bien vu du tout.
Quand j’ai connu Raga, elle avait déjà une quarantaine d’année et vivait avec sa mère âgée. Les deux femmes s’entendaient bien. Le père était mort. Raga était, est toujours, une grande belle femme, blanche, de formes opulentes, (je le dis, parce que en Égypte c’est une vraie valeur, pas comme en France où on les aime maigrichonnes et blondes, mais bronzées) avec des dents éclatantes, et surtout un franc-parler plein d’humour et de créativité linguistique qui lui attire aussi bien la sympathie que la peur.
Elle travaillait dans une sorte de service social affilié aux écoles chrétiennes, et c’était Madame Bon Plan : elle savait vous trouver des places de spectacle à moitié prix, des hébergements improbables dans des lieux de villégiature en été, des sorties originales et pas ruineuses.
Je n’ai jamais osé lui demander pourquoi elle ne s’était pas mariée. Probablement pas parce qu’elle chantait faux (c’est à peu près son seul défaut). Mais je sais que beaucoup de jeunes hommes coptes quittent l’Égypte où ils souffrent d’une discrimination réelle même si elle n’est pas avouée, et où depuis l’avènement d’Anouar el Sadate et son indulgence à l’égard des groupes islamistes, ils ne sont plus en sécurité. Donc, les jeunes filles coptes ont du mal à se caser.
Quand j’ai connu Raga, elle avait déjà une quarantaine d’année et vivait avec sa mère âgée. Les deux femmes s’entendaient bien. Le père était mort. Raga était, est toujours, une grande belle femme, blanche, de formes opulentes, (je le dis, parce que en Égypte c’est une vraie valeur, pas comme en France où on les aime maigrichonnes et blondes, mais bronzées) avec des dents éclatantes, et surtout un franc-parler plein d’humour et de créativité linguistique qui lui attire aussi bien la sympathie que la peur.
Elle travaillait dans une sorte de service social affilié aux écoles chrétiennes, et c’était Madame Bon Plan : elle savait vous trouver des places de spectacle à moitié prix, des hébergements improbables dans des lieux de villégiature en été, des sorties originales et pas ruineuses.
Je n’ai jamais osé lui demander pourquoi elle ne s’était pas mariée. Probablement pas parce qu’elle chantait faux (c’est à peu près son seul défaut). Mais je sais que beaucoup de jeunes hommes coptes
Je sais aussi que son caractère indépendant lui aurait rendu difficile la contrainte du mariage. Raga a en effet une bande de copains, dont j’ai l’honneur de faire partie, elle passe une partie de son temps libre dans des cafés de rue où elle fume bravement des chichas en discutant avec des hommes qui ont laissé leurs femmes à la maison. En tout bien tout honneur. Raga est éminemment fraternelle et loyale.
Tout ça fonctionnait plutôt bien jusqu’au jour où sa maman est morte.
Bien qu’aidant un peu toute sa famille avec son salaire, elle avait réussi à s’acheter un appartement où elle n’habitait pas, mais qui était une assurance pour ses vieux jours (en Égypte, la retraite est toute symbolique, même les anciens combattants font encore le taxi à plus de 70 ans).
Mais, sa maman partie, outre le chagrin qu’elle a éprouvé, elle s’est retrouvée dans l’obligation, n’étant pas mariée, d’aller vivre chez son frère qui, lui, avait une famille.
Donc, voilà Raga, qui avait tenu la maison de sa mère et s’était habituée à y être la maîtresse, obligée de camper sur le canapé du salon, et de laisser ses affaires dans des valises, livres compris, parce que chez son frère on ne lit que la Bible et les journaux.
C’est qu’une femme ne vit pas seule. C’est mal. Il faut qu’elle soit protégée par un homme. Les plus chanceuses passent du père au mari, au moins elles ont leur cuisine pour elles toutes seules, mais les célibataires, veuves, divorcées doivent se contenter d’un frère, d’un oncle, et tant pis si belle-sœur, tante ou autre ne les supportent pas.
Le pieux frère de Raga contrôle son téléphone portable et ses horaires. Plus question de refaire le monde au café avec les copains. Il a une réputation à soutenir, lui. Et pourquoi refuse-t-elle d’épouser un sympathique veuf qui aurait bien besoin qu’on lui tienne sa maison ?
Mais Raga a peut-être trouvé une solution : son frère a un fils adolescent avec qui il ne s’entend pas bien. Elle est donc en pourparlers, l’idée étant qu’elle prenne ce garçon avec elle dans son appartement, ce qui réglerait son problème à elle, tout en permettant à son neveu de respirer un peu loin de ses ennuyeux parents.
Évidemment, il ne partira pas sans avoir été briefé sur ses responsabilités d’homme de la maison. Il faudra qu’il apprenne à surveiller sa tante, à veiller à sa chasteté (à elle), enfin, à être un homme…
La solution, si elle est adoptée, durera ce qu’elle durera. Le neveu un jour se mariera, et comme les appartements sont rares, on trouvera normal que Raga lui offre le sien. C’est ce que ferait une mère. Et elle aura bien de la chance, dans ses vieux jours, de ne pas être seule…
Épisode 3
L’histoire de Baheyya
Je viens de me régaler d’une vieille série égyptienne où le rôle principal est tenu par mon idole, Hoda Soltane.
Hoda Soltane est morte en 2006, et dans cette série, qui s’intitule « al watad » (le pilier, oui, comme la terrible mère dont parle Yachar Kemal, le grand écrivain turc, dans son roman du même nom, que je ne saurais trop recommander), elle est déjà âgée, mais je l’adore à tous les âges de sa vie.
Née en 1925 dans une famille conservatrice du delta, elle n’a pu se réaliser comme comédienne et chanteuse que grâce à son frère Mohamed Fawzy, célèbre musicien qui l’a soutenue et encouragée.
Elle était d’une beauté ravageuse, elle chantait et dansait, drôle, douée, jamais vulgaire. Et elle a eu cinq maris, pas en même temps bien sûr.

Et puis un beau jour elle a décidé de porter le higab. Vous savez, le voile qui cache tout sauf le visage, et dont on a soudain découvert dans les années soixante-dix que c’était un commandement de l’Islam. Passons… Il y a eu à partir de cette époque une sorte de mouvement parmi les actrices de cinéma et de télévision, un certain nombre d’entre elles se sont voilées et ont « fait pénitence » en disant adieu à la scène. On a beaucoup dit qu’elles avaient reçu pour ça un gros chèque de là où vous savez, mais les gens sont méchants. Or Hoda Soltane, elle, fort agacée par ces repentirs dramatiques, a continué à se produire, mais dans des rôles où elle pouvait garder son voile, et elle a déclaré que jouer la comédie n’était pas un péché, que c’était un métier comme les autres, mais qu’il fallait s’en servir pour édifier le public.
À chaque âge sa beauté et ses gloires… de vamp, elle est devenue mère.
La mère, cette revanche de la femme orientale, cette souveraine absolue dans sa maison, commandant à ses filles et à ses brus, dispensant la nourriture et le bon conseil, vendant son or pour établir un fils.
C’est un beau personnage à incarner pour une actrice vieillissante…
Mais je vois aussi la cohorte des mères du cinéma (notamment turc) ou du journal télévisé, les mères anatoliennes, turques ou kurdes, même combat, qui arment elles-mêmes le bras de leur fils en cas de défaillance du mari, pour mettre à mort la fille qui a péché, ou qui a été violée (le résultat est le même), les mères palestiniennes qui poussent des you-yous comme à une noce sur le cadavre de leur fils mort en martyr, même s’il n’était que la pitoyable victime de ceux qui le persuadèrent de commettre un attentat-suicide.
Elles me font de la peine, parce qu’elles perdent leurs enfants bien sûr, mais surtout parce qu’on les a convaincues que c’était un honneur de les perdre.
Même Marie de Nazareth, cette autre Palestinienne, a pleuré au pied de la croix.
Elles, elles ne pleurent pas.
Mais ces femmes de pierre et de fer ont été jeunes, ont bercé des bébés. Quelle a été leur vie, avant le sacrifice final ?
Probablement comme la vie de Hagga Baheyya, que je vais vous raconter. Elle n’a pas eu, Dieu merci, à accomplir ce sacrifice, mais s’il l’avait fallu, elle l’aurait fait.
Je l’ai connue honorée par tous, maîtresse chez elle et cultivant les grandes vertus, mais je connais aussi un peu les coulisses de ce décor.
Baheyya a été mariée dès ses premières règles au maire de son village de Haute-Égypte. Mais comme c’était une enfant terrible, dès le lendemain de la noce, elle a couru pieds nus dans sa belle robe rouge jouer avec les garnements du village comme elle le faisait la veille encore, et le maire a compris qu’il n’en ferait rien, il l’a donc répudiée.
Comment a-t-elle supporté le viol, me direz-vous ? C’est que la violence est quotidienne dans l’éducation des enfants, alors on s’endurcit ; d’ailleurs l’excision lui a probablement appris que cette partie de son corps ne lui appartenait pas, et cette violence de la nuit de noce n’était qu’une raclée de plus, le lendemain il y aurait une robe rouge et un bon repas.
On la remarie dès que c’est possible. Là, elle a un enfant.
Après, je ne sais pas si le second mari la répudie ou meurt, l’un des deux, toujours est-il qu’elle est mariée une troisième fois à un jeune homme pauvre mais très orgueilleux de sa lignée. Dans la campagne égyptienne, il y a trois castes, sans compter les gitans : au bas de l’échelle, les descendants d’esclaves, puis les paysans, aussi purement égyptiens qu’on peut l’être dans un pays ouvert à tous les vents, puis en haut, les « arabes », ceux qui ont la mémoire d’ancêtres venus d’Arabie avec la conquête, parfois avec un arbre généalogique remontant au Prophète. Ceux-ci peuvent épouser dans les deux castes en-dessous d’eux. Mais ne leurs donnent pas leurs femmes. Donc, Baheyya, paysanne, est honorée de pouvoir épouser cet aristocrate sans le sou, qui a sa carte de descendant du Prophète, et elle laisse son fils à la famille du deuxième mari pour pouvoir suivre le troisième au Caire.
Au Caire, l’aristocrate travaille comme manœuvre sur un chantier de construction dans un quartier du centre. L’immeuble terminé, il en devient le concierge et habite une chambre sous l’escalier. C’est là que Baheyya donne naissance aux deux premiers enfants de cette union. Quelques temps plus tard, la famille, comme bien d’autres, colonise la terrasse de l’immeuble où des chambres destinées à être des buanderies les abritent avant d’être progressivement transformées en une sorte d’appartement assez décent, encore qu’illégal. Là naissent quatre autres enfants, plus une paire de jumeaux morts à la naissance. Baheyya élève des poules, des pigeons, il y a même parfois une chèvre ou un mouton. Oui, sur la terrasse.
Comme l’immeuble est proche de la gare, sitôt que des parents et relations arrivent de Haute-Égypte, ils sont accueillis là. Baheyya nourrit tout le monde et lave à la main les lourdes gallabeyyas de ses hôtes. Elle ne sait pas lire, elle assiste terrifiée à l’incendie du Caire en 1952 depuis sa terrasse dont elle ne descend que pour les mariages et les enterrements. Elle ne sait pas ce qui se passe. Pour elle, c’est toujours le même travail et les mêmes soucis.

L’aristocrate lave la montée, vend des boissons gazeuses et nourrit les oiseaux. C’est un homme taciturne, mais pas méchant. Il envoie tous ses enfants à l’école, même les filles, et ça mérite d’être mentionné, ils ne le font pas tous.
J’ai connu Baheyya déjà âgée et abîmée par sa vie de travail. Très pieuse, elle avait une réputation de quasi sainteté, tout en ayant gardé de son enfance une sorte d’espièglerie délicieuse. Elle aimait les parfums et se mettait du khôl aux yeux les jours de fête. Elle était fière de la réussite de ses enfants, ses filles ont fait de bons mariages, sauf l’aînée dont j’aurai à reparler dans une prochaine chronique.
Mais pendant ses dernières années, elle n’adressait plus la parole au père de ses enfants.
– Ya Hagga, est-ce que tu as déjà été amoureuse ?
Elle rit. Non, jamais. Jamais. Elle n’a pas eu le temps. Et l’amour, c’est seulement à la télévision. Dans la vraie vie, il y a la prière, la nourriture, les enfants, la maladie. Le travail. Elle qui ne se plaint jamais, elle souffle :
– Il ne m’a jamais dit merci. Jamais. Pas un mot.
C’est avec ce chagrin qu’elle est morte.
C’était un homme de bien. Franchement, il n’aurait pas pu faire un petit effort ?
Paix à leurs âmes.
———————–
Épisode 4
Celles qui dansent

Désolée, ce mois-ci je n’ai pas tellement regardé de séries, j’étais trop occupée à danser. Oui oui oui, je danse ! Et c’est de danse que je vais parler.
Je vais commencer par un souvenir. J’avais quatre ans, je sortais du bain, j’étais dans l’euphorie de l’eau de Cologne 555 et du Johnson Baby Powder, et je me suis mise à danser. Ma mère m’a tout de suite arrêtée : « ne fais pas ça, c’est indécent».
Bon.
Notre bonne, la vieille Kaokab, dansait en fredonnant et en claquant des doigts. « Elle est folle ».
C’était à Alexandrie dans les années soixante. On admirait les grâces acrobatiques du Lac des Cygnes, mais la danse orientale, c’était mal, dans mon milieu un peu collet monté en tout cas.
De temps en temps, entre copines, on pouvait se déhancher quelques minutes, mais ça se terminait assez vite, nous nous effondrions en riant (un peu trop fort) d’avoir fait quelque chose de vulgaire et d’interdit, quelque chose qui nous troublait curieusement.
Nous étions des jeunes filles distinguées et raisonnables, pas comme la vieille Kaokab.
Et puis la vie m’a conduite à Paris, et quand ma mère est morte, j’ai eu besoin de naître une deuxième fois, et j’ai été timidement, à plus de cinquante ans, et accompagnée d’une amie plus délurée que moi, frapper à la porte du cours de danse orientale d’Anne Benveniste, à Paris.
Anne Benveniste m’a très doucement dépliée, fait comprendre avec très peu de paroles que le corps pouvait être un instrument de musique, et qu’on pouvait danser sans être vulgaire, sans rien faire de honteux.

Malheureusement, les vieilles barbes de mon Égypte bien-aimée n’ont jamais rencontré Anne Benveniste, et les danseuses égyptiennes sont traquées par la police des mœurs.
Une scène du très beau documentaire de mon amie Safaa Fathy « Ghazeia, danseuses d’Égypte » 1993 : la petite fille d’une danseuse campagnarde qui anime mariages et autres fêtes est interrogée par Safaa : « Et toi, tu aimerais être danseuse comme ta maman ? » La petite fille trace des lignes dans le sable et répond sans regarder l’intervieweuse : « Non ». « Pourquoi ? » « Je ne sais pas. C’est mal ».
Mais qu’a-t-elle de si spécial, cette danse orientale qui a envoûté les occidentaux et qui hérisse les faiseurs de lois
Je laisse la parole à Anne Benveniste qui la décrit mieux que je ne saurais le faire :
« Son expression part du bassin, du ventre de façon « organique » et terrienne et se traduit par des mouvements d’isolation ciselés, et contenus. La vigueur des hanches s’accompagne de la précision du mouvement des épaules. Une vibration de l’ensemble du corps peut se propager comme une onde, se figer dans un silence suspendu et se muer en accents ou mouvements fluides.
Son caractère est multiple. Cette danse célèbre le corps d’une manière familière dans le sens où elle parle à chacun de nous, à travers une palette d’émotions présentes dans la musique. Elle est le reflet de l’âme de l’interprète ».
Mais la forme la plus connue, répandue à travers le cinéma égyptien et malencontreusement appelée « danse du ventre » est celle en usage dans les cabarets, où elle se pratique avec un costume qui en accentue la dimension sensuelle. Là où l’initié identifie la maîtrise du mouvement et sa beauté, le public voit d’abord la nudité et la provocation sexuelle.
J’ai parlé de cinéma ? Paradoxalement, rares sont les films égyptiens sans danse ! Je vais donc quand même vous parler d’un film : c’est « Wedad el Ghazeyya », avec la flamboyante Nadia el Gendy dans le rôle de Wedad, la danseuse gitane. Orpheline, elle danse pour gagner son pain, mais se fait respecter ; c’est très clair : elle danse quand elle veut, pour qui elle veut, et ce n’est pas parce qu’elle danse qu’elle va consentir à ce que vous savez. Sauf qu’évidemment, les prédateurs ne l’entendent pas de cette… oreille-là.
Heureusement elle est défendue par le nouveau commissaire de police, le beau et taciturne Mahmoud Yassine. Et elle tombe amoureuse de lui, et lui d’elle, c’est merveilleux, ça finit très mal, mais c’est quand même merveilleux. Parce que naturellement, une fois amoureuse de lui, elle n’a qu’une ambition : ne plus danser que pour lui, ce qui est l’objectif premier d’une femme qui se respecte.
Pardonnez-moi ici de faire un peu de pédagogie : dans les sociétés de culture musulmane, la démarcation entre espace privé et espace public est très importante. En occident c’est différent, l’espace public est goulûment ouvert à l’intime. Mais en Égypte, danser entre femmes dans les fêtes est une chose, danser en public en est une autre.
Il y a une notion fondamentale dans le monde musulman, c’est le satr. Le satr, c’est à dire le voile que Dieu tend entre nous et le malheur, entre nous et la honte, entre nous et la misère. Celui ou celle qui par malchance ou par vice n’est pas couvert de ce voile est nu, exposé au malheur, à la honte de tendre la main, son corps est offert à qui en veut, sa réputation est mâchonnée par toutes les bouches.
Ce qu’une femme demande à un homme, c’est le satr. Couvre-moi. Protège-moi de la convoitise des autres. Nourris-moi. Sois un père pour mes enfants. En échange, je ne serai qu’à toi, je ne danserai que pour toi.
Elle est bien malheureuse ou bien perverse, celle qui danse pour n’importe qui en échange d’argent. Elle montre son corps, elle l’offre. On n’a pas encore découvert les bienfaits d’une société érotisée, une femme qui se montre est dans le meilleur des cas une allumeuse, une paresseuse qui ne sait pas faire autre chose pour gagner sa vie. Et ça, croit-on, tout le monde peut le faire.
Pourtant, il y a eu de grandes artistes reconnues comme telles dans la danse orientale. Mais il fallait à ces femmes qui tenaient à leur vocation des hommes suffisamment forts socialement et psychologiquement pour se permettre de les épouser… et ça c’est rare…
Aujourd’hui la situation est encore plus difficile avec l’hypocrisie généralisée qui permet de censurer les danseuses alors que grâce à Google, tous les adolescents ont accès à la pornographie et font leur éducation sexuelle devant l’écran de leur téléphone.
L’Islam n’a jamais encouragé la danse des femmes quelle qu’elle soit, et la pudibonderie affichée ne permet même plus de distinguer le beau du médiocre et le médiocre de l’obscène.
Au temps des califes, les musiciennes et les danseuses étaient le plus souvent des esclaves. Les femmes « libres », non esclaves, bénéficiaient du « satr » et vivaient à l’abri des regards masculins, se consacrant à leur principale activité de génitrices.
Les luttes de femmes en Égypte ont leurs priorités, héritées de cette époque : les droits civiques, déjà si maigrement concédés même aux hommes. Elles ont conquis de haute lutte le droit à l’éducation, au travail, au divorce, le droit de voyager sans autorisation du mari, elles écrivent, elles chantent, elles travaillent dans tous les domaines. Et ce faisant, elles s’habillent, elles se couvrent, elles s’empaquettent, elles se voilent. Leur libération, c’est l’accès à la même respectabilité que celle des hommes, par l’intellect essentiellement, et par la piété, garantie que leur indépendance ne met pas en danger les valeurs consensuelles. Quant à la liberté du corps, dont la notion est récente en occident, elle n’est pas au centre de leurs préoccupations. Et quand des femmes occidentales – ou occidentalisées – se mobilisent en ce sens, cela ne fait que discréditer les mouvements profonds des femmes égyptiennes, aussitôt soupçonnées d’être le cheval de Troie du néo-colonialisme.
La rivière, dit un très beau conte soufi, ne craint pas de perdre son identité. Pour continuer à exister, elle sait s’évaporer, retomber en pluie, couler sous la terre. La danse poursuit elle aussi son chemin à bas bruit, parce que les femmes sont toujours des femmes et que la musique continuer à jouer.
Si aujourd’hui les danseuses russes ou américaines concurrencent les Égyptiennes, si les Parisiennes viennent recueillir cette tradition auprès d’Anne Benveniste, peut-être ne faut-il pas y voir une rivalité, mais un soutien. Les sœurs occidentales des Égyptiennes leurs conservent cet art et le font évoluer, en attendant qu’un jour les femmes égyptiennes, enfin réconciliées avec leur corps, puissent se remettre à danser.
__________________________________________________________________
Illustrations: Z. ZAZA
Lire également:
Archives des Roman | Apprendre l’arabe avec DILAP
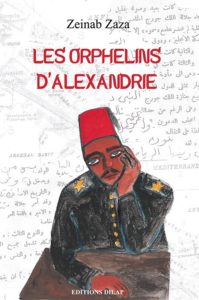
Copyright Editions Dilap. Tous droits réservés