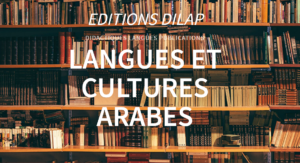La Relation de voyages d’Ibn Jûbayr (1145-1217) s’avère être au sommet du genre dit ziyârât, consistant en la relation du pèlerinage d’un musulman occidental dans les Lieux saints, sorte de reportage avant la lettre, où l’auteur-pélerin rapporte avec minutie et souvent talent littéraire, les étapes de son périple, donnant ainsi des informations précieuses sur les contrées traversées, les villes où il a séjourné ainsi que des descriptions précises des moeurs et coutumes des gens rencontrés. L’auteur, secrétaire du gouverneur almohade de Grenade, a effectué son premier pèlerinage à la Mecque en 1184/85. Il fournit un panorama exceptionnel des Etats et populations musulmanes rencontrés au Maghreb et au Moyen-Orient à l’heure de la montée en puissance de l’’Egypte ayyoubide de Saladin, juste avant la prise de Jérusalem par ses troupes en 1187.
Dans son ouvrage, Le voyage d’Ibn Jubayr , l’auteur raconte entre autre l’arrivée du bateau rempli de pèlerins venus d’Andalousie à Alexandrie et l’accueil plutôt étonnant des autorités portuaires, pourtant sous les ordres du célèbre Saladin, réputé pour sa son sens de la justice, en plus des autres qualités qu’on lui a attribuées. Les pèlerins sont d’abord rassemblés sur le bateau; les douaniers enregistrent leurs noms, leurs origines et le nombre de bagages qu’ils transportent avec eux. Puis, on leur intime l’ordre de descendre un à un, avec leurs bagages sous les bras. Au sol, les bagages sont fouillés de fond en comble, sans ménagement, les objets jetés à même le sol et beaucoup d’affaires sont ainsi perdues, raconte avec une pointe d’amertume l’auteur qui a dû subir les mêmes humiliations. Il révèle que les douaniers ont exigé le paiement d’une somme en plus de la zakât légale (dîme que tout pèlerin paye aux autorités du pays qu’il traverse). Visiblement scadalisé, Ibn Jubayr conclu que » si le souverain, avec ce que l’on connaît de lui de qualités avait été au courant, il n’aurait jamais permis de tels agissements ».
Ibn Battouta
Le chef-d’œuvre d’Ibn Battûta (1304-1368 ) appartient à un autre genre, celui de la rihla. Ici, l’apologie de la religion cède le pas au simple plaisir de la découverte, tant pour le voyageur que pour le lecteur. Ses pérégrinations font exploser les frontières du voyage et étendent leurs horizons jusqu’à la côte de Malabar et à l’île de Ceylan à l’Est, et atteignent l’Andalousie et le Mali à l’Ouest : ce n’est pas un hasard si l’itinéraire et l’œuvre d’Ibn Battûta sont sans cesse comparés à ceux de Marco Polo (1254-1324). Le Moyen-Orient reste au cœur du récit, puisque c’est avant tout un pèlerinage à La Mecque qui a été l’occasion du départ d’Ibn Battûta. Mais il n’est ici plus que la pièce centrale d’un monde musulman aux dimensions beaucoup plus vaste et varié.
Rassemblés en un seul volume, ces récits permettent d’appréhender de manière originale l’histoire du Moyen-Orient médiéval. Les Documents sur la Chine attestent de la prééminence de la ville califale de Bagdad au IXe siècle et du dynamisme de ses relations commerciales, qui s’étendaient jusqu’à la Chine avant le sac de Canton de 878. Avec Ibn Fâdlan, on assiste à l’une des dernières grandes entreprises d’expansion d’un califat abbasside certes déclinant mais n’ayant encore rien perdu de son prestige et de ses ambitions. Tout a déjà changé dans la Relation d’Ibn Jûbayr : ce n’est plus le califat de Bagdad qui polarise la vie politique du Moyen-Orient au XIIe siècle. C’est désormais vers l’Egypte ayyoubide de Saladin que convergent les regards des observateurs musulmans, de Grenade jusqu’au Hedjâz. Enfin, avec Ibn Battûta, c’est l’éclatement politique du monde musulman du XIVe siècle qui se révèle au fil de l’écriture. Avec lui, le Moyen-Orient entre dans sa modernité politique. Mais on remarquera surtout que tous ces récits sont écrits à la première personne, de sorte que pour chacune de ces périodes, ils présentent le monde arabe médiéval tel qu’il a été vu et vécu par ses contemporains.
Signalons pourtant que nombre de spécialistes relèvent d’énormes erreurs d’ordre géographique ou de descriptions approximatives, ce qui fait dire à certains, que certains périples n’ont jamais été effectués par l’auteur, qui les aurait simplement rapportés grâce aux témoignages de camarades de voyage ou à des gens rencontrés au cours de ses pérégrinations et qui lui auraient rapprté leurs aventures, elles mêmes vraies ou inventées…
Un Moyen-Orient très urbain
Dans ce cadre, on peut d’abord noter que nos explorateurs envisageaient l’Islam médiéval d’abord et avant tout comme une civilisation urbaine. Ces voyageurs, eux-mêmes issus de milieu urbains et assez aisés étaient plus préoccupés par la vie urbaine, et plutôt indifférents ou aveugles à la vie rurale et bédouine. Ils sembleraient même véhiculer cette idée chère à Ibn Khaldûn que le nomadisme est hostile au progrès et que les bédouins ruinent l’économie de la ville et dissolvent l’ordre social ». Les voyages sont ainsi résumés à des itinéraires allant de ville en ville, entrecoupés de « vides » échappant à toute description.
Dans chaque cité visitée et décrite, ce sont d’abord les signes du pouvoir, du dynamisme religieux et de la prospérité économique qui attirent l’attention des voyageurs : les palais, les mosquées et madrasas (écoles religieuses) et enfin les bazars. Surtout, ces endroits sont systématiquement attachés à la dynastie régnante, de sorte qu’ils constituent les lieux où le pouvoir de ces familles s’incarne. Ainsi, lorsqu’il passe à Alexandrie, Ibn Jûbayr renvoie le prestige de la ville à celui de son maître, Saladin : « Citons parmi les vertus et les titres de gloire de cette ville dont l’honneur revient en réalité à son sultan, les madrasas et les couvents qui s’y trouvent ! ». Cette manière d’identifier un Etat et son souverain à une capitale et ses monuments est sans doute décisive pour comprendre l’importance de « l’art princier » dans les stratégies de légitimation du pouvoir des sultans et émirs du Moyen-Âge.
Des cités prestigieuses, avec des spécifités pour chacune
Pourtant, on chercherait en vain à établir une hiérarchie de ces cités décrites par les récits de ces voyagers-écrivains : on constate en effet que les ensembles urbains décrits ne sont pas figés une fois pour toute, mais se réaménage au fil du temps.C’est notamment le cas de Baghdad. La description qu’en fait Ibn Jûbayr est particulièrement riche, dans la mesure où elle permet de montrer que le déclin de la ville a commencé bien avant son sac par les troupes mongoles de Genghis Khan en 1258 : « Aucun beau monument n’y attire le regard et n’y invite l’homme pressé à la flânerie. » Pourtant, la ville conserve tout son prestige et continue de faire rêver le voyageur : « La splendeur féminine de Baghdad s’épanouit grâce à son air et à ses eaux. C’est cela qui la rend célèbre, connue et renommée entre toutes les villes ». Malgré sa relative marginalisation politique, sa prééminence culturelle est également restée intacte : ses mosquées sont « innombrables » et ses bains publics son innombrables , et Ibn Jûbayr remarque la qualité de l’enseignement qu’on y donne, en comparaison de ce qu’il a vu ailleurs dans le dâr-al-islâm (territoires musulmans). Au XIVe siècle, tout a changé : Baghdad « ressemble à la vieille femme que la jeunesse a fuie et dont la beauté dont elle était gratifiée a disparu » . C’est désormais Damas qui attire l’attention du voyageur : « En Orient, aucune ville ne l’égale pour la beauté de ses marchés, de ses vergers et de ses cours d’eau et la grâce de ses habitants [». E
Les limites du dâr al-Islâm
Ibn Jûbayr et Ibn Battûta n’ont pas seulement visité le dâr-al-islam, ils en ont également éprouvé les limites spatiales, culturelles et religieuses. Leurs écrits témoignent en particulier de la complexité des relations entre musulmans et chrétiens aux marges des Etats islamiques, mais aussi entre sunnites et chiites en leur sein même.
A lire Ibn Jûbayr, on comprend que « l’expérience de frontière » a quelque chose d’anormal, tant il était convaincu que l’empire musulman pouvait certes connaître des dissensions, mais géographiquement, il était un et indivisible. Ses allers et venues dans les villes sous domination chrétienne sont ponctués de malédictions lancées à l’endroit des occupants : « Akka’ (Saint-Jean-d’Acre) : que Dieu la détruise et la rende aux musulmans ! ». Il en souligne sans cesse l’impureté et les mauvaises mœurs, surtout concernant la condition des femmes, qu’il juge trop libérale. Pourtant, en lisant entre les lignes du texte, on comprend que la cohabitation interreligieuse était beaucoup plus pacifique qu’Ibn Jûbayr ne se plaît à le dire. Au cœur de l’évêché chrétien de Tyr, il retrouve ainsi une communauté musulmane active, pratiquant sa religion sous la protection des chrétiens gouvernant la ville. De même, il souligne que la guerre ayant lieu entre Saladin et les Royaumes chrétiens n’a pas de répercussions sur les populations civiles, vivant en bonne entente : « Les hommes de guerre s’occupent de leurs conflits pendant que les autres sont en paix, les biens matériels appartenant aux vainqueurs. C’est ainsi que les gens de ce pays se comportent alors qu’ils sont en guerre».
Il arrive même qu’on passe de la cohabitation pacifique à la véritable vie en commun. Ainsi à Bânyâs : « L’exploitation de cette plaine est partagée entre les Rûms et les musulmans, suivant un règlement dits de partage car les deux parties se partagent les récoltes à égalité». On pourrait multiplier les exemples, mais il est clair qu’une véritable « société de frontière » s’est constituée au Moyen-Orient au XIIe siècle. Avec Ibn Bâttutâ, les traces d’une présence chrétienne ont pourtant presque disparu. On devine que les rapports qu’entretiennent les quelques communautés subsistantes avec la population musulmane sont toujours de qualité, puisque le voyageur souligne l’hospitalité dont elles ont su faire preuve à son égard.
En réalité, il est frappant de constater que chez les deux auteurs, les tensions sont moins fortes aux frontières du monde musulman qu’elles ne le sont en son sein même entre groupes sunnites et chiites. La condamnation de ces derniers par Ibn Jûbayr est catégorique : « l’Islam n’est respecté qu’au Maghreb car son souverain suit une voie toute tracée qui n’est pas encombrée de sectes nouvelles et hétérodoxes. Dans tous les pays orientaux, ce ne sont que passions, innovations, sectes égarées et schismes ». Ibn Battûta insiste quant à lui sur les situations d’extrêmes tensions opposant les deux communautés. Lors de son séjour en Irak, il assista à une scène au cours de laquelle la population de Bagdad menaça de mettre à mort les représentants du sultan chiite Muhammad Khudhâbandah si celui-ci persistait à vouloir amender le rite sunnite en vigueur dans cette ville. Bref, dans les deux récits, l’impression générale est que les sociétés du Moyen-Orient médiéval sont davantage marquées par des querelles internes à l’Islam que par des conflits interreligieux.
L’envers du pouvoir
Ces textes écrits à la première personne ne permettent pas seulement d’appréhender lignes de tensions divisant les sociétés arabes médiévales. Ils permettent également de comprendre quel rapport entretiennent ces sociétés avec leurs souverains. Parce qu’ils donnent la parole aux gouvernés, les récits de voyage permettent de jeter un autre regard sur les pratiques et les discours du pouvoir dans l’Islam médiéval.
La richesse des deux principaux récits est à cet égard inégale. Ibn Battûta se contente de reproduire des images idéales et stéréotypées des sultans et émirs qu’il rencontre, de sorte qu’il n’apporte aucune nuance à la représentation d’eux-mêmes que ces souverains entendaient véhiculer. On en trouvera un exemple dans sa description élogieuse du sultan syrien Abu ‘Inan : Ibn Battûta n’aurait « jamais vu aucun roi se conduire avec autant de perfection et d’équité ». Cette adhésion mécanique aux discours officiels s’explique par la position sociale de l’auteur : il est avant tout courtisan, et c’est à cette fonction fragile qu’il doit les faveurs que lui accordent les princes, indispensables à la poursuite de son voyage
Ibn Jûbayr fait preuve d’une attitude éminemment plus critique vis-à-vis des pouvoirs en place. Il partage avec Ibn Battûta une même représentation de ce que doit être un prince idéal : celui-ci doit se distinguer par sa justice, sa foi, et son respect du droit coranique. Mais contrairement à Ibn Battûta, Ibn Jûbayr se sert de cette représentation comme d’une grille de lecture pour juger l’action de ses contemporains. Ainsi l’émir du Hedjâz Mukhtir, gardien des Lieux saints, fait-il l’objet des plus vives critiques de la part de l’auteur, parce qu’il utilise son pouvoir « comme une source de profits illicites et s’en [sert] comme prétexte pour dépouiller les pèlerins de leurs biens ». Le voyageur fait ici référence aux taxes sur les pèlerins mises en place par l’émir de la Mecque, qu’il juge illégitimes en regard du droit islamique. A cet émir s’oppose Saladin, le « sultan équitable » remplissant toutes les attentes de l’auteur : équité, protection des pèlerins et sens de la justice . Celui-ci a pacifié les territoires égyptiens et aboli l’impôt prélevé sur les pèlerins : il est par conséquent en mesure de s’attirer leur reconnaissance. L’adhésion aux discours officiels du pouvoir n’est donc pas systématique : elle est conditionnée à la conformité de l’action du souverain aux représentations mentales et aux attentes de la société. Le texte d’Ibn Jûbayr témoigne ainsi de la potentialité critique de la pensée politique islamique du Moyen-Âge, que l’on a trop souvent tendance à sous-estimer.