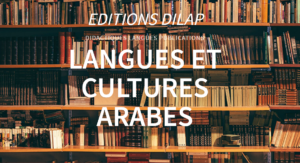Le cinéma algérien à l’époque coloniale
De 1896 à 1937
Par Jean-Pierre Frey.
Architecte sociologue.
Jusqu’à la Libération le cinéma français tourne un certain nombre de films se passant dans les colonies françaises dont trente-trois fictions ont l’Algérie pour décor et trois seulement la ville d’Alger. L’un est le remake d’un autre Sarati le terrible (Mercanton, 1923 et Hugon 1937) et le troisième est le film de Julien Duvivier. La Casbah d’Alger est ici reconstituée aux studios Pathé de Joinville comme la ville de Sfax (Tunisie) pour La Maison du Maltais de Pierre Chenal. Seuls quelques extérieurs sont filmés à Alger. Le scénario s’y prête mais Julien Duvivier avait tourné presque entièrement au Maroc Cinq gentlemen maudits (1931) et La Bandera (1935). Le cinéaste n’en est donc pas à son premier film « exotique » (on peut y inclure le curieux Golgotha tourné juste avant La Bandera, évocation de la vie du Christ dans lequel Jean Gabin joue Ponce Pilate…).


Pépé le Moko Pépé le Moko peut être vu comme un film raciste quand le seul personnage algérien, l’inspecteur Slimane, est un personnage inquiétant. II est du reste interprété par un acteur français (Lucas Gridoux), une nouvelle fois dans un rôle de fourbe (après celui de Judas dans Golgotho). Pépé lui déclare d’ailleurs : » Avoir à ce point-là une gueule de faux jeton, ça devient de la franchise ! ». Pourtant à la sortie du film Emile Vuillermoz écrit : » Ne voyez-vous pas d’ici la brillante campagne d’opinion que l’on peut amorcer dans certains milieux anti français contre notre politique coloniale, en faisant observer que de notre aveu nous sommes incapables d’organiser l’Algérie, puisque sa capitale est repaire inexpugnable de bandits et de hors-la-loi ?… « . Enfin, après la guerre d’indépendance, le film a été rejeté par la premiè re génération de cinéastes algériens qui y voyaient l’emblème du film exotique fait par et pour les Français.
Pépé le Moko est davantage une histoire où la colonie est un ailleurs dépaysant qu’un film colonial. Il appartient à la veine du réalisme poétique où le protagoniste dont les traits sont toujours ceux de Jean Gabin, ne peut fuir pour changer de vie, pour échapper à son des tin. Le déserteur de Quai des brumes ne peut quitter Le Havre, l’ouvrier du Jour se lève est bloqué dans sa chambre. Ici Pépé a réussi à partir, il ne peut seulement pas revenir en France. Tel un Robin des Bois moderne (c’est un voleur apprécié de toute la Casbah), il ne peut quitter son repaire sans se faire arrêter. Comme Fréhel pleurant sur ses amis de la Place Blanche, il ne lui reste qu’à rêver à Pigalle, au Paris perdu.
Chef d’une bande de malfaiteurs, Pépé se cache depuis deux ans avec sa bande dans la Casbah d’Alger. Aidée d’un indicateur, la police cherche à l’attirer hors de la vieille ville où il est pratiquement imprenable.
Source: Connaissance du cinéma.
Les Frères Lumière à Alger

Le cinématographe vient de naître. Alexandre Promio, l’un des plus célè bres opérateurs des Frères Lumière qui revendique l’invention du travel ling, filme Alger. Huit films d’une durée de 40 secondes chacun, mon trent la Place du Gouvernement (aujourd’hui Place des Martyrs) vue depuis un tramway, la rue Bab-Azoun, un marché animé, la circulation des piétons et des véhicules, le port, un paysage en bord de mer.
Films sur la guerre d’Algérie
Par Benjamin Stora
Historien
Commençons par le cinéma algérien qui naît, essentiellement, après l’indépendance des années 1960. Pendant la guerre, par l’absence d’image du côté des Algériens, comparée à celle des images officielles de l’armée française, est significative du déséquilibre du conflit entre les armées régulières d’un Etat puissant, et des maquisards. Les films militants, tournés du côté algérien, de René Vautier (L’Algérie en flemme) ou Yann Le Masson (J’ai 8 ans) sont soumis à la censure officielle et ne sont pas distribués en salles. Après l’indépendance de 1962, se voulant en rupture avec le cinéma colonial pour qui « l’indigène » apparaissait comme un être muet, évoluant dans des décors et des situations « exotiques », le cinéma algérien témoigne d’abord d’une volonté d’existence de l’Etat-nation. Les nouvelles images correspondent au désir d’affirmation d’une identité nouvelle. Elles se déploient d’abord dans le registre de la propagande, puis, progressivement, dévoilent des « sujets » de société.
 A l’origine du cinéma algérien, il y a cette question des films « vrais », « authentiques », celle de l’équilibre fragile entre la nécessité de raconter la vraie vie du colonisé et le besoin de s’échapper du ghetto identitaire construit par l’histoire coloniale. Entre sentimentalisme exacerbé et discours politiques, les premières histoires ont le mérite de rendre compte que les gens ne sont pas seulement en guerre contre un ordre ou soumis à lui, mais aussi se parlent et même se racontent des histoires personnelles. Dans les années 1970, Mohamed Lakhdar Hamina s’empare du thème avec Le Vent des Aurès, tourné en 1965, l’histoire d’un jeune qui ravitaille des maquisards, se fait arrêter, et que sa mère recherche désespérément dans les casernes, les bureaux, les camps d’internement. Décembre, sorti en salles en 1972, montre la capture de Si Ahmed et « interrogé » par les parachutistes français. Chronique des années de braise (palme d’or au festival de Cannes 1975) qui ne traite pas directement de la guerre d’indépendance, son récit s’arrêtant à novembre 1954, alternent les scènes de genre (la misère de la vie paysanne) et recherche d’émotion portées par des personnages fragilisés (une famille emportée dans la tourmente de la vie coloniale). Patrouille à l’Est d’Amar Laskri, (1972), Zone interdite d’Ahmed Lallem, (1972) ou L’Opium et le bâton, d’Ahmed Rachedi, sont autant de titres programmes qui, sur le front des images, dessinent le rapport que les autorités algériennes veulent entretenir avec le « peuple en marche ».
A l’origine du cinéma algérien, il y a cette question des films « vrais », « authentiques », celle de l’équilibre fragile entre la nécessité de raconter la vraie vie du colonisé et le besoin de s’échapper du ghetto identitaire construit par l’histoire coloniale. Entre sentimentalisme exacerbé et discours politiques, les premières histoires ont le mérite de rendre compte que les gens ne sont pas seulement en guerre contre un ordre ou soumis à lui, mais aussi se parlent et même se racontent des histoires personnelles. Dans les années 1970, Mohamed Lakhdar Hamina s’empare du thème avec Le Vent des Aurès, tourné en 1965, l’histoire d’un jeune qui ravitaille des maquisards, se fait arrêter, et que sa mère recherche désespérément dans les casernes, les bureaux, les camps d’internement. Décembre, sorti en salles en 1972, montre la capture de Si Ahmed et « interrogé » par les parachutistes français. Chronique des années de braise (palme d’or au festival de Cannes 1975) qui ne traite pas directement de la guerre d’indépendance, son récit s’arrêtant à novembre 1954, alternent les scènes de genre (la misère de la vie paysanne) et recherche d’émotion portées par des personnages fragilisés (une famille emportée dans la tourmente de la vie coloniale). Patrouille à l’Est d’Amar Laskri, (1972), Zone interdite d’Ahmed Lallem, (1972) ou L’Opium et le bâton, d’Ahmed Rachedi, sont autant de titres programmes qui, sur le front des images, dessinent le rapport que les autorités algériennes veulent entretenir avec le « peuple en marche ».
 Le cinéma algérien examine, fouille alors dans le passé proche, mais il n’y a pas d’image première de référence. Tout est à reconstruire à partir de rien. Quelque chose relève ici de l’insolence des pionniers, ceux pour qui tout n’est que (re)commencement. Cette image sans passé (il n’y a rien sur les figures anciennes du nationalisme algérien, de Messali Hadj à Ferhat Abbas, ou de Abane Ramdane à Amirouche) cache peut être aussi la hantise de se voir dévoré par des ancêtres jugés archaïques. Ce cinéma décomplexé vis-à-vis d’aînés peut donc avancer rapidement, et la production première de films sur la guerre d’indépendance est importante. L’absence de mélancolie apparaît comme une différence centrale avec les films français sur l’Algérie et la guerre, travaillés quelquefois par les remords, et la sensation permanente d’oubli…. Car il existe une perpétuelle sensation d’absence de films français de cinéma de fiction sur la guerre d’Algérie.
Le cinéma algérien examine, fouille alors dans le passé proche, mais il n’y a pas d’image première de référence. Tout est à reconstruire à partir de rien. Quelque chose relève ici de l’insolence des pionniers, ceux pour qui tout n’est que (re)commencement. Cette image sans passé (il n’y a rien sur les figures anciennes du nationalisme algérien, de Messali Hadj à Ferhat Abbas, ou de Abane Ramdane à Amirouche) cache peut être aussi la hantise de se voir dévoré par des ancêtres jugés archaïques. Ce cinéma décomplexé vis-à-vis d’aînés peut donc avancer rapidement, et la production première de films sur la guerre d’indépendance est importante. L’absence de mélancolie apparaît comme une différence centrale avec les films français sur l’Algérie et la guerre, travaillés quelquefois par les remords, et la sensation permanente d’oubli…. Car il existe une perpétuelle sensation d’absence de films français de cinéma de fiction sur la guerre d’Algérie.

Le vent des Aures.
Algérie 1996 >1h30 >couleurs>vostf Réalisation: Mohamed Lakhdar Hamina.
Pendant longtemps, chaque sortie en France d’un film sur la guerre d’Algérie était l’occasion d’un cliché journalistique obsédant, faisant retour de manière obsédante, perpétuelle : la non-existence de films de fiction traitant de cette séquence. Pourtant, pendant la période de la guerre elle-même, des cinéastes, et pas n’importe lesquels, ont essayé de fabriquer des films sur la guerre d’indépendance algérienne. Citons Alain Resnais, Alain Cavalier, Jacques Rozier et Jean-Luc Godard (Le Petit Soldat). Après les « événements » de mai juin 1968, d’autres cinéastes se sont lancés à l’assaut de ce morceau d’histoire très proche (cinq ans seulement séparent la fin de la guerre d’Algérie de 1968…) en essayant de montrer quelque chose. On citera René Vautier (Avoir 20 ans dons les Aurès), Yves Boisset (RAS), ou Laurent Heynemann (Le Question, une adaptation du célèbre livre d’Henri Alleg). Même Claude Berri s’est essayé à cette histoire avec Le Pistonné. Les années 80 et 90 sont également l’occasion d’une tentative de déploiement mémoriel par l’image avec les films de Philippe Garel, Pierre Schoendorffer, Alexandre Arcady, Gérard Mordillat, Gilles Béhat, Serge Moati et Pierre Delerive. Emerge à ce moment-là de façon remarquable un cinéma de femmes sur cette guerre avec les films de Brigitte Rouen (Outre-mer), de Dominique Cabréra (De l’autre côté de la mer) et de Rachida Krim (Sous les pieds des femmes). De son côté, le cinéma algérien s’avance vers plus de complexité. Dans Les Sacrifiés, d’Okacha Touita, (1982), on voit la condition misérable des immigrés algériens en France, et, surtout, les terribles règlements de compte entre militants du FLN et du MNA. Avec Les Folles années du twist, de Mahmoud Zemmouri, (1985), le spectateur découvre l’insouciance d’une jeunesse algérienne dans la fin de guerre (le film se passe au moment de la signature des accords d’Evian de mars 1962), et les combattants de la « vingt-cinquième heure » qui s’apprêtent à rejoindre le camp des vainqueurs. Ces deux films, dans des registres très différents, adoptent un comportement de rupture avec l’unanimisme nationaliste qui régnait jusque là. Ils annoncent, sur le mode tragique ou humoristique, les « événements » d’octobre 1988, qui voient la jeunesse algérienne ébranler le système du parti unique.

Ahmed Rachedi, dans C’était la guerre en 1993, n’hésitera plus à évoquer la violence interne du mouvement nationaliste (liquidations physiques dans les maquis). Mais la terrible tragédie qui secoue l’Algérie dans ces années 1990 va interrompre le tournage de films en Algérie. Le cinéma français, à ce moment, se « réveille » sur des questions touchant à l’histoire tragique vécue par les Algériens, avec deux films : Nuit noire, d’Alain Tasma, (2005) qui montre les massacres d’immigrés à Paris dans la nuit du 17 octobre 1961 ; et Le TOrahison, de Philippe Faucon, (2006), plongée dans les profondeurs de l’Algérie rurale. Avec la vie quotidienne de soldats sous l’autorité de jeunes officiers français, apparaissent des villageois algériens déplacés brutalement, éclatent les accrochages et les « interrogatoires », et circulent les sentiments de quatre « Français de souche nord-africaine », selon l’expression de l’époque. Ce beau film montre des soldats trop jeunes confrontés à choix difficiles, tragiques.
Alger à l’écran : 1897-1962
Par Jean-Pierre Frey
Architecte-Sociologue
Sous un ciel parfois ombrageux, la capitale algérienne, désormais bardée d’antennes paraboliques qui sont autant de poings levés en quête d’un ailleurs médiatique, s’éveille à peine de la nuit agitée de cette fin tragique du XXe siècle. Alger au cinéma a déjà eu plus d’une vie et ne manque pas de vitalité malgré ou peut-être à cause de ses multiples désordres. Nous partirons volontiers de l’idée qu’il existe une Alger cinématographique qui ne dévoile qu’une partie des charmes de la ville effective. Par fausse pudeur ou pour mieux préserver les refuges des amours secrètes, elle ne dévoile jamais que ce que l’Histoire lui a dévolu comme rôle dans des rapports qui la dépassent largement.

1897-1954 : La ville fantasmée
De 1897 au 1er novembre 1954, les pays occidentaux – et principalement la France – ont tourné près de 90 films en Algérie, ou du moins en ont situé partiellement ou totalement les récits. Un Sud fait de routes incertaines, de sable chaud, de paysages désertiques (où les oasis sont plus des postes militaires avancés que de véritables villes) s’oppose à une côte méditerranéenne où Alger supplante largement les autres villes. Port et porte d’entrée dans le prolongement du PLM, c’est une ville dont la Casbah en front de mer affiche une façade lumineuse. Mais c’est aussi une sorte de cul-de-sac à l’image des impasses de son dédale de ruelles protégées des regards par la pénombre, et qui rejette dans son ombre portée ;e reste de la ville. Dans cette période plus que par la suite, les paysages naturels de la côte ou du Sud font pièce à des décors urbains souvent reconstitués en studio pour des raisons de commodité de tournage. En dehors de vues générales de la ville et de quelques scènes de rue, ce sont des petites villes de province et l’image canonique du bled qui supplantent la subtilité et les nuances d’un véritable espace urbain. Les villes sont alors plus des étapes, des points de passage ou des points de chute d’une colonisation laborieuse ou martiale, que des lieux d’une villégiature enviable. Alger en revanche représente en même temps que le lieu de tous les dangers et de tous les mystères d’un Orient à forte charge sensuelle et érotique, le siège d’une mondanité originale et cosmopolite. Elle est faite de l’arrogance revancharde des petits blancs contre les adversités de l’existence, d’une condition prolétarienne européenne cherchant une émancipation sous des cieux supposés plus cléments, d’une bourgeoisie terrienne ou de robe volontiers condescendante et se croyant en pays conquis, d’administrateurs égarés ou éconduits et de la masse diffuse ou grouillante d’un petit peuple indigène de confession musulmane ou israélite, d’origine arabe, turque, kabyle, berbère et même nègre. Sorte de Babylone aux accents et sabirs divers, jardin d’acclimatation pour des plantes plus ou moins exotiques mais toujours à la recherche de leurs racines, Alger fut longtemps et reste un espace où deux villes se côtoient sans jamais vraiment s’ignorer, et où les populations s’épient et se jaugent au bord de tensions contenues, mais aussi où s’affrontent et éclatent les rancœurs mal enfouies et les frustrations profondes. La casbah est ainsi l’envers du décor de la ville européenne.
 Pour Alger, comme du reste pour les autres villes, c’est l’éclipse. Elle devient un nom, des bruits, des rumeurs, des accents et des instantanés plutôt qu’un ensemble cohérent de vues articulées, d’autant que sa physionomie changera brutalement avec le départ précipité d’une large partie de ses habitants. La ville n’est en fait plus la même quand, dans un décor qui se maintient vaille que vaille (tout au moins pour les quartiers les plus centraux), les Algériens prennent la place des Français. Acteurs et figurants décrédibiliseront ainsi – voire discréditeront – la vraisemblance des images et des scènes dès lors qu’un tortionnaire breton, un légionnaire allemand, un fonctionnaire métropolitain seront joués par des Algériens. Les fausses blondes, passe encore !, mais que dire de ces Pieds-noirs n’arborant plus leur accent ? Reste que quelques images volées furtivement à la réalité des émeutes et de la répression viendront alimenter le stock des plans que l’on pourra insérer par la suite comme des lambeaux de vérité dans des films portant, tous, les traces d’un déchirement et de blessures mal cicatrisées.
Pour Alger, comme du reste pour les autres villes, c’est l’éclipse. Elle devient un nom, des bruits, des rumeurs, des accents et des instantanés plutôt qu’un ensemble cohérent de vues articulées, d’autant que sa physionomie changera brutalement avec le départ précipité d’une large partie de ses habitants. La ville n’est en fait plus la même quand, dans un décor qui se maintient vaille que vaille (tout au moins pour les quartiers les plus centraux), les Algériens prennent la place des Français. Acteurs et figurants décrédibiliseront ainsi – voire discréditeront – la vraisemblance des images et des scènes dès lors qu’un tortionnaire breton, un légionnaire allemand, un fonctionnaire métropolitain seront joués par des Algériens. Les fausses blondes, passe encore !, mais que dire de ces Pieds-noirs n’arborant plus leur accent ? Reste que quelques images volées furtivement à la réalité des émeutes et de la répression viendront alimenter le stock des plans que l’on pourra insérer par la suite comme des lambeaux de vérité dans des films portant, tous, les traces d’un déchirement et de blessures mal cicatrisées.